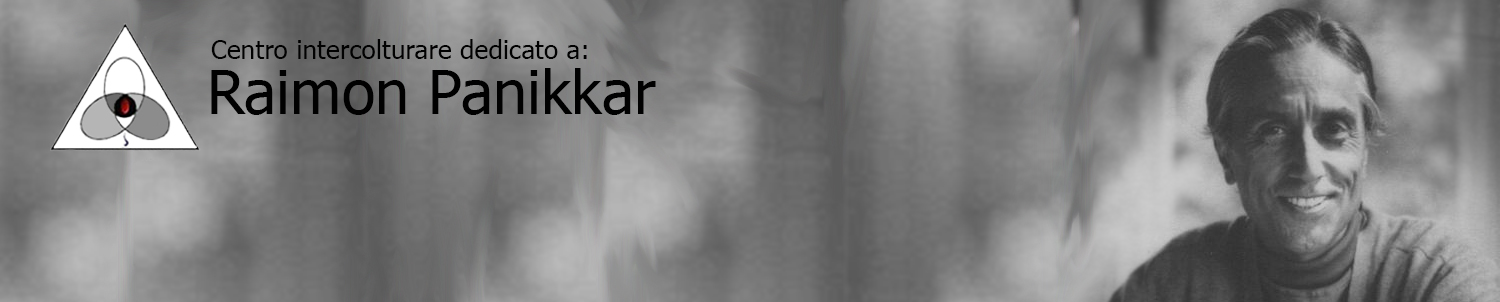Juan Carlos VALVERDE, doctorant de l’université de Strasbourg en Théologie et Sciences Religieuses
Juan Carlos VALVERDE, doctorant de l’université de Strasbourg en Théologie et Sciences Religieuses
1. Introduction
Raimon Panikkar, scientifique, philosophe et théologien espagnol, invite, dans ses multiples travaux, à recouvrer la structure trinitaire de l’être humain et de toute la réalité et propose, en outre, comme possible solution à la crise écologique, de faire un pas de plus vers l’écosophie, c’est-à-dire, à prêter attention à la sagesse de la terre. Le point de départ est un changement radical de l’homme lui-même, mais aussi de la théologie. Car elle doit pouvoir répondre aux questions de la société contemporaine.
La première tâche et la plus urgente consiste, dit-il, à réaliser un nouveau pacte, une nouvelle alliance avec notre corps (notre Corps !), un pacte de fidélité avec nous-mêmes. A. Leopold proposait une « éthique de la terre » et M. Serres un « contrat naturel », Panikkar, lui, une « nouvelle conscience ». Le premier affirmait avec raison qu’il n’existe pas « […] d’éthique chargée de définir la relation de l’homme à la terre, ni aux animaux et aux plantes […] ».[1] Il faudrait peut-être élargir les frontières de la communauté de façon à ce qu’on tienne compte aussi de la terre (le sol, les montagnes, les plantes, les animaux, entre autres). Car tous les êtres ont le droit d’exister, indépendamment du bénéfice de l’être humain. Il nous faut une pensée plus relationnelle. Une telle vision ferait passer l’homo sapiens de conquérant à membre et citoyen de la seule communauté qui existe. La terre ne serait plus un adversaire, mais un compagnon de voyage. Car homme et nature ne font qu’un seul et même Corps.
Force est de constater que l’éthique théologique a été réduite à l’impératif moral de Kant, c’est-à-dire à la question de l’obligation.[2] Avec S. Pinckaers[3], nous affirmons qu’il faudrait compléter cet impératif moral avec la question du bonheur qui renvoie au sens de la vie. Il faudrait que nous nous demandions, dans les pages qui suivent et à la lumière de la proposition de R. Panikkar, si l’éthique que l’on a est suffisante pour apporter une réponse satisfaisante aux problèmes posés par la crise écologique ou bien s’il nous en faut une autre. Tenter de trouver une éthique écosophique sera le but de cet essai.
Remettre la théologie en chantier
La profondeur de la crise écologique dans laquelle nous sommes a mis en question tous les schémas, tant scientifiques que sociologiques, philosophiques et autres. La théologie doit aussi se sentir concernée. Nous affirmons que la théologie ne s’est pas encore (ou pas encore tout à fait !) rendu compte de l’urgence de la crise écologique. L’éventuelle disparition de l’être humain, tout au moins d’une partie de l’humanité – déjà en cours, hélas ! – devrait être l’objet d’une plus sincère préoccupation.
A la lumière de la pensée de R. Panikkar, nous croyons que trois aspects doivent être repensés, à propos d’une évolution de la théologie. Premièrement, la relation universel-particulier-singulier ; deuxièmement, la notion de territoire et, troisièmement, l’hypothèse de l’inter-fécondation des cultures.
Relation universel-particulier-singulier. Dans la société contemporaine l’universel, le particulier et le singulier se débattent constamment. Dans une approche plus « éco-théologique », un premier changement s’impose : l’universel ferait plutôt référence à la totalité (l’ensemble des êtres humains, des animaux, des plantes et des choses dites « inertes »), alors que le singulier renverrait de préférence aux individus (un être humain, un animal, une plante ou une pierre), tandis que le particulier ferait référence au milieu auquel ils appartiennent (social, culturel et historique, mais aussi géo-biologique). Une éthique éco-théologique doit tenir compte de l’ensemble, mais aussi des caractéristiques des individus et de leurs milieux de vie. « Aucune tentative de restauration écologique du monde ne triomphera tant que nous n’arriverons pas à considérer la Terre comme notre corps et le corps comme notre soi-même »[4], affirme radicalement Panikkar.
Reterritorialisation : décoloniser l’imaginaire théologique. En relation rigoureuse avec ce qui précède, un autre changement est exigé : reterritorialiser notre monde, physique et imaginaire. P. Shepard affirmait : « La pensée écologique implique une vision qui ne s’arrête pas aux frontières »[5], car la pollution n’a plus de bornes. La nouvelle éthique devrait donc rayer les frontières physiques et intellectuelles qui la limitent tout en respectant les différences culturelles. L’éthique théologique traditionnelle témoigne d’une société qui n’existe plus, des structures géographiques et mentales qui ont changé. G. Casalis le dit fort bien : « […] propre de la réalité familiale telle que la produit la société occidentale et telle que la reflète la morale prétendument chrétienne : un micro-organisme aussi clos qu’uniformisé, avec d’incroyables prétentions à l’universalité ».[6] Il est alors impératif qu’un processus de reterritorialisation[7] voit le jour. Il serait un réapprentissage, une récupération des attitudes positives envers la vie. Pour cela, il faut tout d’abord « décoloniser l’imaginaire »[8], ce qui veut dire croire à la possibilité de construire un monde alternatif à partir d’autres valeurs. Comme disait A. Costa, il est question d’une « éthique de la suffisance pour tous et non pas seulement pour quelques-uns ».[9] Pour Panikkar, décoloniser l’imaginaire en éthique théologique signifie ne plus vivre de l’espérance d’atteindre le ciel dans un « temps » inconnu et, entretemps, vivre de manière humiliante et inhumaine. Décoloniser l’imaginaire en théologie implique de reconnaître qu’une seule culture ne peut pas offrir la réponse aux complexités de la crise actuelle.
Pour une inter-fécondation des cultures. Le mot « fécondation » est très important. Car il n’y a pas de vie sans fécondation. L’être humain, le cosmos et le divin, pour vivre, ont besoin d’une fécondation mutuelle. Cela veut dire qu’il n’y a pas d’horizon possible sans relations constitutives. Il s’agit de reconnaître que l’autre a aussi le droit d’exister. Panikkar le dit ainsi : « […] nous avons besoin de l’inter-fécondation des cultures. […] nous devons apprendre à écouter ce que les autres cultures, celles qui ne dominent pas, ont à nous dire lorsqu’elles sont confrontées aux problèmes politiques […]. Nous devons connaître ses propositions et les étudier. Il ne s’agit pas de proposer des réformes mineures, mais d’envisager d’autres solutions radicalement différentes ».[10]
Faut-il une nouvelle éthique théologique ?
L’éthique théologique que nous avons reçue a été bâtie sur l’accomplissement des normes, sur le respect de la loi. Avec A. Thomasset nous croyons que la « loi et toutes les règles du fonctionnement social ne suffisent pas pour susciter la solidarité nécessaire à la santé morale et politique des sociétés ».[11] Il faut quelque chose de plus que le « devoir faire ». Il est impératif que l’on récupère l’éthique du bonheur, que l’on s’intéresse à cette dimension essentielle de la vie quelque peu oubliée. La société ne peut fonctionner que si l’on recouvre le goût de vivre ensemble et le désir de viser le bien commun. Or, la vertu est étroitement liée aux notions de bonheur, de fin ultime, d’exercice et d’apprentissage.
Cette éthique ne se conjuguera pas au singulier, ce sera une éthique éco-théologique conjuguée au pluriel, elle s’intéressera à l’éducation personnelle dans le but de surmonter l’individualisme narcissique de l’individu contemporain. Comme nous le rappelle encore une fois A. Thomasset : « Face à une éthique qui, dans le christianisme, s’intéressait surtout à l’évitement du mal et au péché, s’ouvre à nouveau le souci de redécouvrir la visée positive du bien à faire, du bonheur à rechercher, du progrès possible ».[12]
2.
3. Présupposés d’une éthique cosmothéandrique
Trois pourraient être les piliers de notre proposition. Premièrement, la valeur relationnelle de tout ce qui existe ; deuxièmement, une nouvelle conception de l’être humain et troisièmement, une nouvelle approche épistémologique.
La valeur relationnelle de tout ce qui existe
L’être humain a été depuis longtemps considéré comme étant supérieur et extérieur à la nature[13] et celle-ci a été réduite au statut d’objet faisant face à un sujet. Il nous faudrait donc déconstruire cette détermination métaphysique, en vue d’élaborer une nouvelle proposition qui pense la réalité comme un ensemble de relations constitutives, autrement dit, formuler une hypothèse qui propose la « valeur relationnelle » de tout ce qui existe.
D’après un certain nombre d’auteurs, il suffit de prendre en considération les intérêts des générations futures à jouir des services écologiques et des ressources spirituelles que leur offre la nature pour justifier sa protection. Pour ces auteurs, le respect que l’on doit aux êtres humains est suffisant pour prendre soin de la nature. Pour d’autres[14], il suffirait d’être membre de la communauté de vie pour que toutes les entités aient une valeur intrinsèque. J. B. Callicot confirme la valeur intrinsèque des entités, humaines et non humaines, comme étant ce qui appartient à la nature essentielle ou à la constitution d’une chose. Callicot prétend ainsi rompre avec la distinction cartésienne qui fait la différence entre sujets et objets. Les choses doivent être valorisées pour elles-mêmes, en tant que fin en soi, affirme cet auteur. Il faut en outre montrer une valeur intrinsèque des entités non pas seulement dans les individus mais dans de vastes ensembles. Callicot propose de « valoriser des espèces, des écosystèmes, des océans, l’atmosphère, la biosphère – tous et chacun pour ce qu’ils sont en eux-mêmes ainsi que pour leur utilité ».[15]
Notons que chez la plupart de ces auteurs, défenseurs et opposés à ladite valeur intrinsèque, l’être humain et les êtres qui l’entourent sont tous considérés d’une manière isolée. L’expression « valeur intrinsèque des entités » renvoie aux individus et ne fait pas forcément penser à l’ensemble de la communauté. La valeur intrinsèque ferait donc partie de l’essence ou des attributs de tous les êtres, de tous les individus considérés isolément. D’après l’intuition de Panikkar, il faudrait plutôt faire l’énoncé éthique suivant : les entités non humaines, tout comme les êtres humains, ont de la valeur parce qu’elles font partie d’un tout inséparable. L’intuition cosmothéandrique dit que Dieu, Homme et Monde sont en relation intrinsèque et constitutive. Panikkar reconnaît la valeur des choses non pas tant en elles-mêmes, mais davantage en tant que membres d’un ensemble indivisible. Il est clair que reconnaître l’importance d’une chose en fonction de l’existence des autres implique aussi reconnaître la valeur en soi. Il est néanmoins absolument nécessaire d’expliciter cette relativité.
Une anthropologie cosmothéandrique
Nombreux sont les auteurs qui croient que la crise écologique a révélé une profonde crise anthropologique. D’après eux, il faut repenser le concept de sujet, il faudrait « […] un changement dans la manière dont l’homme se pense et pense son être à la nature »[16], affirme C. Pelluchon. Pour Panikkar, le temps est venu d’un changement : « Notre temps est mûr pour cette mutation anthropologique ».[17] L’homme est remis en question par le monde lui-même, par une nouvelle relation avec les animaux, les plantes et les choses dites « inertes ». A la lumière de l’intuition de Panikkar, nous proposons le principe suivant comme base de cette nouvelle anthropologie : « L’homme est une réalité cosmothéandrique ».[18] Cela veut dire que l’être humain est en relation d’inter-in-dépendance vis-à-vis de Dieu et du Monde.
Le principe cosmo-thé-andrique fait reconnaître le divin, l’humain et le cosmique comme les trois dimensions de la réalité. Le Theos renvoie à la dimension divine de la réalité, c’est l’ « impénétrable liberté »[19], le caractère inépuisable de tous les êtres, leur ouverture et leur incomplétude. L’Anthropos représente la dimension humaine de la réalité, c’est la conscience présente. Panikkar le dit ainsi : « […] les eaux de la conscience humaine baignent toutes les berges du réel – même si l’homme ne peut pas pénétrer le cælum incognitum de l’intérieur – et pour cela même l’être de l’homme entre en relation avec la réalité tout entière ».[20] Finalement, le Kosmos désigne la dimension matérielle de la réalité. Tout être se trouve dans le monde et participe de sa singularité : « Il n’y a rien qui, en entrant dans la conscience humaine, n’entre pas en même temps en relation avec le Monde. […] toutes les choses qui existent ont une relation constitutive avec le Monde de la matière/énergie et de l’espace/temps »[21], écrit notre auteur.
De ce principe général se dégagent trois affirmations que nous ne pouvons pas développer. Nous réaffirmons l’idée qui dit que l’homme est un : corps, âme et esprit, mais aussi qu’il est infini : en même temps transcendant et immanent. Nous soutenons que l’homme est avant tout personne, il est relation et les relations configurent son être au monde.
Une épistémologie perspectiviste
Panikkar rejette l’idée que l’homme puisse avoir accès à une réalité objective, sans tenir compte, par exemple, des différents contextes culturels. Car pour lui, il n’y a pas de faits objectifs ou en soi, tout comme il n’y a pas de connaissance d’une chose sans la perspective de celui qui connaît. Cela veut dire qu’il n’existe pas d’absolu métaphysique, épistémologique ou moral. L’objectivité ou connaissance objective est telle dans la mesure où il existe un sujet qui définit et qui donne les critères d’une telle connaissance. Pour atteindre la connaissance pleine, il faudrait plus que la méthode scientifique, affirme notre auteur. La science moderne, basée sur l’analyse et les mesures, ne peut pas « sauver » l’homme. La totalité de la réalité, l’harmonie de cette réalité, ne peut pas être perçue que par la raison dialectique. Pour atteindre cette harmonie il faut une troisième dimension que Panikkar appelle « intuition », « troisième œil », ou simplement « amour ».
La notion d’amour chez Panikkar renvoie à une connaissance qui se produit grâce au fait que celui qui connaît sort de soi-même, en d’autres termes, il aime cela même qu’il reconnaît à travers l’amour comme étant sa propre connaissance. Cette sortie de soi-même est l’amour. Aimer veut dire se donner soi-même.[22] Il y a là un parallélisme explicite avec la Trinité Divine. L’amour ne peut pas être défini si ce n’est que par ses « fruits », il est un « saut centrifuge, hors de notre centre […] ».[23] La vraie connaissance implique donc de sortir de soi-même.
4.
5. Proposition d’éthique cosmothéandrique
Reprenons ici une expression chère à Panikkar, à savoir, « Colligite fragmenta »[24] tirée de l’évangile de Jean. Il faut ramasser les fragments pour que rien ne se perde. La sagesse consiste à (re)trouver l’harmonie perdue, car « la réalité est harmonie ».[25] Il s’agit donc de réunir les parties dispersées, certaines même méprisées, voire négligées.
Le philosophe Ecossais A. MacIntyre considère que la morale dans nos jours est fragmentée : « […] nous ne possédons plus que des fragments d’un modèle conceptuel, fragments auxquels manque le contexte qui leur donne sens. […] nous disposons d’un simulacre de morale […] »[26]. Pour lui, les philosophies d’aujourd’hui sont incapables de penser ce qu’elles étaient dans le passé et, le pire, c’est qu’il ne semble pas exister un accord moral possible dans le présent. Peut-on en dire autant pour la théologie ? La société contemporaine insiste principalement sur l’individu et ses droits. Il faudrait, suivant aussi bien MacIntyre que Panikkar, ramasser les débris et essayer de construire une théorie qui aille dans le sens contraire de l’individualisme.
Même si notre théologien espagnol n’a pas construit explicitement une éthique écosophique, à partir des éléments qu’il nous a livrés nous osons maintenant ébaucher une telle éthique.
Le point de départ : la communauté cosmique
Le point de départ de l’éthique, implicite dans la pensée de Panikkar, est sans aucun doute la notion de communauté, comprise comme corps total et cimentée sur les relations trinitaires. L’être humain et le cosmos sont insérés dans la vie trinitaire dans une relation constitutive.
La vie n’est plus conçue comme un espace limité à l’individualité, elle a maintenant des dimensions cosmiques ; notre corps individuel n’est plus isolé, ce n’est plus une chose solitaire qui se retrouve avec d’autres choses par hasard ; il n’y a pas de hasard, car ce corps fait partie d’un Corps plus grand qui le comprend et le complète. Panikkar affirme que l’on vit « […] dans un cosmos, c’est-à-dire dans un ordre bien établi […] »[27] voulant dire qu’il s’agit d’un grand organisme[28] qui fonctionne ensemble, même si chaque membre a aussi un fonctionnement particulier. La vie, bien évidemment, n’est pas le privilège de l’homme, celui-ci participe de la vie de l’univers.
Le point de départ de notre éthique éco-sophique implique une nouvelle cosmologie qui considère la terre comme un tout. Or, l’homme d’aujourd’hui a dévitalisé la terre, elle n’est plus que matière et énergie. Du coup, l’homme est devenu un être isolé, sans compagnons de voyage. Panikkar croit que : « Le Ciel s’est transformé en un projet humain, un idéal plus ou moins heuristique ; et le cosmos n’est pas plus qu’une condition nécessaire pour l’existence humaine. Cependant, ni le Ciel ni le cosmos n’ont une réalité propre. C’est cela l’humanisme radical de notre temps. Il a converti l’homme en un Dasein isolé […] ».[29]
Une éthique cosmothéandrique du sens de l’existence
« Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? » De la réponse donnée découlent autant la manière de se comprendre soi-même que celle d’être au monde. Aristote pensait à un premier moteur que Leibniz nommait Dieu, tout comme Descartes ; mais que peut-on ou doit-on en dire aujourd’hui ? Quel est le sens de l’existence ? Est-il important de se poser cette question ? La réponse n’est pas univoque. Panikkar, lui, reprend la vieille notion de bonheur et de sens de l’existence. Tout ce qui existe a un sens, une fin et doit donc l’atteindre.
Il importe de mentionner deux notions qui aideront à mieux comprendre la pensée de notre auteur. Il s’agit du « désir » et de l’ « aspiration ». Le désir est défini comme la soif qu’a l’homme de posséder quelque chose, un objet, qui est justement l’objet du désir. Cet objet met l’appétit en mouvement dans le but de l’obtenir. Mais il y a aussi l’aspiration. Elle renvoie à un dynamisme intérieur, à une force qui vient vers l’être et qui ne recherche aucun objet spécifique. C’est l’aspiration qui nous fait rester vivants. L’aspiration est la « condition première pour le déploiement de l’espérance »[30] et suscite de surcroît la foi.
Aujourd’hui tout se passe comme si l’homme avait horreur du vide et utilisait, pour remplir sa vie et son temps, les moyens les plus variés : la recherche des richesses, le travail, le plaisir, la science, la politique, l’amour, entre autres. Panikkar propose, comme le fait Pinckaers, de définir la morale comme la « science qui enseigne à l’homme le sens de la vie ».[31] Ainsi, l’éthique devrait donc s’occuper de l’ensemble des actes humains et non seulement des obligations morales.
Une éthique cosmothéandrique de la vulnérabilité et du « care »
L’éthique écosophique dont nous parlons, basée sur les relations intrinsèques entre toutes les entités, doit se penser de deux points de vue, à savoir, la vulnérabilité et le « care ».[32] Tous les êtres partagent la vulnérabilité et ont donc besoin du « care ».
Le « care » dans la société occidentale a été assumé par les femmes. Nous croyons, à la suite de notre auteur, qu’il est impératif d’adopter un discours plus féminin d’amour et d’affection. Panikkar écrit : « Nous avons besoin d’une attitude ‘féminine’ pour la recevoir [la paix]. Notre civilisation dominante a relégué le féminin à une position d’infériorité. Et, en disant ‘féminin’, je ne me réfère pas seulement aux femmes dans nos sociétés mais à l’attitude féminine sur laquelle, évidemment, les femmes en savent beaucoup plus que les hommes. […]. Je me réfère à l’attitude réceptive face à la vie, les choses, la réalité ; à l’attitude qui, en recevant et embrassant, transforme ».[33] Il est question d’une attitude plus contemplative ou réceptive et moins rationnelle ou « agressive »[34] de la vie. Pour trouver une adéquate solution aux problèmes écologiques, affirme C. Larrère, il faudrait changer de métaphore, il faut renoncer à la « wilderness » masculine pour faire place au « jardin » comme métaphore du féminin « qui n’implique pas de rapport immédiat à la domination ».[35]
Vulnérabilité, « care » et interdépendance s’opposent à l’abstraction d’êtres isolés et indépendants. L’écosophie de Panikkar est une invitation à s’engager activement dans et pour la vie ; il est question de « cultiver » l’amour envers tout ce qui nous entoure. « Cultiver » et « prendre soin »[36] semblent aller à peu près dans la même direction. J. Tronto donne une définition intéressante du « care :
[Le care est] une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre ‘monde’, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe, en soutien à la vie.[37]
Le « care » est donc compris comme étant une activité dont tous ont besoin et qui doit être exercée par tous. Il est toutefois question d’une activité et non pas d’une réflexion ou d’une activité intellectuelle : « […] ce n’est pas seulement affaire de connaissance ou d’affection, elle est affaire d’apprentissage de l’expression adéquate et d’éducation de la sensibilité ».[38] Panikkar aurait sans doute préféré le mot « expérience ». Le « care » serait ainsi non seulement une activité qui se fait et qui passe, mais une expérience qui jaillit du plus profond de l’être. Prendre soin de tous les êtres vulnérables fait partie de tous les êtres, même si « on ne naît ‘caring’, on le devient […] par le travail ».[39] Le « care » s’apprend et peut devenir une vertu. Tout ce que nous faisons doit être fait dans le seul but de maintenir et perpétuer l’aventure de la vie.
Si nous pensons que la crise écologique touche de manière particulière le pauvre, il faudrait considérer le « care » comme étant le « pouvoir des faibles »[40], ce qui veut dire que ceux qui prennent soin des autres procurent une assistance essentielle à la Vie. Dans la chaîne de relations que la réalité conforme, tous les éléments doivent se soucier des autres, pourrait dire Panikkar. C’est le sens des expressions « se cultiver » et « cultiver » que notre auteur aime tant. Il affirme : « Le sens de la vie consiste à faire de chacun de nous une œuvre d’art. Pour réaliser cette création artistique nous avons besoin de la collaboration de tout l’univers, depuis le divin jusqu’à la matière ou jusqu’à nos prochains ».[41] L’éthique que nous proposons invite d’une manière toute naturelle à la sollicitude envers les plus faibles. Etre moralement bon signifie donc que chacun s’efforce de répondre aux demandes de soin.
On pourrait encore une fois se poser la question : quelle image doit-on se faire de l’homme de notre société industrialisée et développée ? Comment l’homme se perçoit-il lui-même ? M. Gaille parle de « miroir moral » et se pose une autre question : « qui voulons-nous reconnaître dans ce miroir ? Il s’agit de définir la personnalité morale que nous souhaitons incarner dans cette relation ».[42] Une éthique écosophique est telle parce que tous les membres de la communauté de vie se soucient les uns des autres. Ce n’est pas parce qu’il est un commandement qui exige la justice et le respect d’autrui qu’il faut agir, mais parce que cela surgit de l’intérieur comme un besoin. C’est un état d’esprit qui doit s’acquérir, tout en étant en même temps un don, une grâce.
Il est question sans doute aussi de responsabilité. Celle-ci ne peut pas être limitée à un ensemble de règles à respecter ou à accomplir. Ce n’est pas seulement ce qu’on a ou n’a pas fait. J’agis parce que l’autre qui est dans le besoin fait partie de moi-même, parce qu’il est altera pars mei, parce qu’en lui tendant une main, j’œuvre pour le bien et l’intérêt de tous, de la vie elle-même. La vie n’est plus une aventure solitaire. Disons-le avec les mots d’A. Comte-Sponville : « Il s’agit d’habiter cet univers qui est le nôtre, ou plutôt qui nous contient, où rien n’est à croire, puisque tout est à connaître, où rien n’est à espérer, puisque tout est à faire ou à aimer ».[43] Comte-Sponville cite une phrase émouvante et tout à fait dans le sens de notre auteur espagnol : « Je ne désire rien du passé. Je ne compte plus sur l’avenir. Le présent me suffit. Je suis un homme heureux, car j’ai renoncé au bonheur »[44], ou bien, comme disait M. Eliade citant le Sâmkhya-Sûtra : « Seul est heureux celui qui a perdu tout espoir ; car l’espoir est la plus grande torture qui soit, et le désespoir le plus grand bonheur ».[45] Le sage n’espère rien, dit la tradition orientale, car il ne désire plus que le réel.
Une éthique cosmothéandrique des vertus
L’homme contemporain a peur du silence, a peur de se retrouver seul avec soi-même. Or l’éthique cosmothéandrique est une éthique des vertus qui insiste, d’une part, sur l’importance de la sécularité et, d’autre part, sur l’intériorisation comme condition essentielle pour l’acquisition des vertus.
a.
b. La sécularité
La sécularité, chez Panikkar, met l’accent sur le présent, si bien que c’est ici et maintenant que tout se joue et non pas dans un avenir inconnu. Sans rejeter explicitement l’eschatologie chrétienne traditionnelle, notre auteur souhaite dévoiler une spiritualité fataliste qui fait que le pauvre et ceux qui souffrent se résignent à leur condition en pensant au « futur » heureux dans le ciel. Or, le Royaume des cieux est ici. La vie heureuse ne doit pas être reportée ou renvoyée à plus tard, elle est possible même au milieu des souffrances, ici et maintenant. La sécularité, le sæculum, est ainsi le lieu où se joue le destin de tout ce qui existe, non seulement de l’homme mais de tout : « Les choses humaines sont divines, le ciel est sur la terre, la compassion et l’amour sont les vertus suprêmes, la quotidienneté est la perfection et le séculier est sacré ».[46] Avec radicalité notre auteur affirme qu’il ne faut pas attendre un monde meilleur dans un endroit paradisiaque où il n’y aura plus de douleur ou de souffrance. Dire que ce monde est un lieu de souffrance et de douleur et qu’il y en aura un autre où tout cela sera dépassé invite au rejet du monde présent. Au milieu des maux de ce monde, il faut construire sa béatitude. La temporalité a donc un caractère ultime. L’éthique écosophique insiste ainsi sur l’importance du présent. Elle ne le méprise, ni ne le présente comme un pas préalable ou inférieur à la vie bonne définitive. Il n’y a plus deux cités, les « dieux » sont ici engagés dans la seule aventure de la réalité. Ils ne nous attendent pas dans l’Ouranos pour y vivre dans la plénitude et le bonheur.
c. L’intériorisation
L’homme de la société contemporaine, avec la poursuite du plaisir et de l’avoir, cherche à remplir le vide en satisfaisant ses désirs ; mais sent en même temps le besoin urgent de retrouver l’unité perdue. L’homme de nos jours est un homme fragmenté, scindé, divisé ; dans sa recherche du sens, il a cru pouvoir remplir le vide en se tournant vers l’extérieur. Or, ce n’est pas en dehors de lui-même qu’il va retrouver la route. Panikkar croit qu’il faut plutôt se tourner vers l’intérieur.
L’intériorisation dont parle Panikkar renvoie à ce qu’il appelle la « quête du centre ». On pourrait rapprocher cette idée de celle d’Augustin lorsqu’il dit de Dieu qu’il est intimior intimo meo. Non pas que Dieu se substitue au moi individuel, mais dans le sens où Dieu, la transcendance, l’Absolu, l’Inachevé, se trouve aussi dans le plus profond de l’être humain, à l’intérieur et non pas en dehors de lui-même. Le centre dont parle Panikkar est une image pour indiquer l’ « endroit » le plus profond ou significatif de l’être humain où se trouvent les stimulations, les motivations, les intuitions, enfin le lieu où tous les mouvements trouvent leur origine. Avec ses mots toujours surprenants, notre théologien espagnol écrit : « Le centre, d’autre part, n’a pas de dimension. Et finalement, il n’existe pas ; il est vide, et c’est dans la mesure où il le sera qu’il restera immobile pendant que la surface est agitée. Une autre façon de le décrire serait de dire qu’il est absolu, c’est-à-dire illimité, sans liens, libre et pour cela compatible avec tout dans la mesure où il reste détaché ».[47] Si ce centre est vide c’est parce que l’homme a opté plutôt pour l’extérieur, la vie alors n’aura pas de sens. Il faut donc remplir ce centre, il deviendra ainsi l’élan pour la mobilisation extérieure.
Intérioriser exige de « faire silence », se taire pour pouvoir écouter la voix intérieure. Non pas que les mots ne soient pas importants, mais qu’ils sont seulement secondaires. Et pour qu’ils soient remplis de sens, il faudrait qu’ils soient non pas précédés mais accompagnés du silence. Pour notre auteur, les paroles doivent être prononcées lorsque la conscience a été éveillée, ce qui permet « de voir que la parole est parole précisément parce qu’elle-même est incarnée par l’œuvre et la grâce de l’esprit ».[48]
d. Les vertus
Il ne faut pas perdre de vue le contexte dans lequel cette réflexion a lieu : la crise écologique et la possibilité qu’elle implique d’une destruction totale de la vie sur terre. Dans ce sens, il n’est pas question ici de relancer la discussion générale sur les vertus, ni de proposer une nouvelle liste de vertus. Comme MacIntyre l’a bien démontré dans son ouvrage Après la vertu, celles-ci apparaissent et disparaissent en fonction de plusieurs facteurs, notamment du contexte historique et culturel.
Malgré l’importance que nous lui accordons, il faut dire que le concept de vertu est pour nous subordonné à celui de tradition et en relation étroite et dépendante avec la vie qui la précède. C’est pour cela qu’on donnera ici beaucoup d’importance aux récits, à la vie comme étant une unité de sens et non pas des fragments isolés. MacIntyre affirme avec raison que : « L’unité d’une vertu dans une vie n’est intelligible que comme la caractéristique d’une vie unitaire, d’une vie qui peut être conçue et évaluée comme un tout ».[49] Ce qui correspond très bien à la visée de notre théologien, R. Panikkar. La vie est un tout inséparable, elle n’est pas faite de moments décousus et sans rapport les uns aux autres. La vie est un récit enchâssé dans une multitude de récits interconnectés. Je suis le personnage principal de mon récit, mais le personnage secondaire de nombreux autres récits. Ainsi, les « morceaux » d’histoire se retrouvent dans une seule et même histoire, dans une seule et même aventure : la Vie.
La recherche personnelle du bonheur se fera toujours dans une communauté particulière laquelle favorise ou peut favoriser un certain nombre de formes institutionnelles qui aideront ou non à apprendre l’exercice des vertus. Aussi les vertus ne peuvent-elles être détachées ni de leur contexte historique ni des autres personnes. Cela veut dire qu’une éthique écosophique accorde beaucoup d’importance à la tradition. La société individualiste contemporaine a voulu rayer toute relation et toute tradition pour instaurer un nouveau style de vie dans lequel la seule chose qui compte est l’individu solitaire. Or, l’histoire de ma vie s’insère dans l’histoire d’une famille, d’une communauté, d’une tribu, d’un pays et, bien entendu, de la communauté planétaire, laquelle se glisse aussi dans une histoire plus vaste mais inconnue ou méconnue : la vie du cosmos. Vouloir supprimer les origines signifie donc couper les racines et déformer les relations.
Les vertus ne sont pas des qualités humaines figées pour toujours ; elles ne doivent pas non plus être considérées comme étant universelles ; nous proposons plutôt d’essayer de bâtir des formes locales de communauté dans lesquelles la pratique des vertus puisse être recouvrée et renouvelée. Dans le contexte d’une « révolution » écologique, et à la lumière de la pensée de notre théologien espagnol, nous croyons ne pas nous tromper en privilégiant les vertus que voici.
La justice
La justice est pour notre auteur « la reconnaissance du véritable ordre des choses et l’engagement d’une praxis qui soit en harmonie avec cet ordre […] ».[50] Tout comme les anciens, Panikkar parle d’ordre, en opposition au désordre, à la disharmonie. Justice, ordre et harmonie deviennent dans la pensée de Panikkar des synonymes. Harmonie veut dire « un espace dans lequel il y a une place pour tous, sans réductionnismes unitaires »[51], ce qui veut dire aussi que rien n’est superflu. Cet ordre suppose la reconnaissance de ce qui est juste et une praxis en accord avec cette conviction. Panikkar croit à un véritable ordre cosmique.
Chez Panikkar, la justice inclut le concept oriental de dharma, c’est-à-dire ce qui maintient la cohésion de l’univers. Le dharma est l’ordre adéquat et le lieu naturel des choses. Si quelqu’un exploite un autre, cela rompt l’ordre des choses, tout comme si quelqu’un collabore à un système qui a pour fin l’enrichissement des uns au détriment des autres. L’injustice serait donc pour notre auteur le « péché foncier »[52] car il va à l’encontre de la réalité.
Le dialogue
Dialogue et hospitalité vont ensemble dans la pensée de notre auteur. On pourrait les prendre pour des synonymes. L’hospitalité est une notion d’une très grande actualité. Elle consiste à accueillir chez soi des visiteurs ou des étrangers avec générosité. Ce « recevoir chez soi » implique également passer du temps avec le nouvel arrivé, il suppose aussi un approfondissement de la relation, on quitte la superficie pour creuser plus profondément.
La Trinité Divine (Père, Fils, Esprit Saint) ainsi que la Trinité Radicale (Dieu, Homme, Monde) sont telles car il existe en elles un dialogue intrinsèque permanant, autrement dit des relations constitutives. Les différentes dimensions qui les constituent sont en tant que les unes « dialoguent » avec les autres. Même si Panikkar ne dit pas explicitement que le dialogue est une vertu, nous croyons ne pas nous tromper en le proposant comme tel. Il est indispensable dans notre contexte actuel. En effet, la société contemporaine individualiste a du mal à reconnaître l’autre comme un partenaire, comme un compagnon de voyage. L’homme contemporain a du mal à accueillir, il a du mal à recevoir dans l’hospitalité parce qu’il a peur. C’est inévitable, il faut dialoguer car l’autre fait partie de moi, de nous ; il est altera pars mei, il est « cette dimension cachée et inconnue qui fait partie de moi […] ».[53] Panikkar parle du dialogue comme d’une vertu qu’il faut cultiver.
Ce dialogue est un art qui « suppose technê et praxis, gnose et théorie ».[54] Il implique aussi d’aller au-delà de nos paramètres pour nous submerger dans un processus participatif. Dans ce processus une « herméneutique diatopique »[55] s’impose, c’est-à-dire plonger dans l’univers de l’autre pour essayer de le comprendre. Le dialogue implique d’abord de se connaître soi-même autant que l’autre. Il suppose aussi faire des efforts pour parler, pour comprendre et donner à comprendre. Il nous faut « une transformation héroïque »[56], assure Panikkar, un changement radical, dans le but de s’ouvrir à une existence dialogale. Le dialogue est une vertu car il doit être appris et entretenu.
La confiance
La confiance chez Panikkar évoque l’espérance. Confier veut dire espérer et ce mot renvoie en même temps à la foi. Avoir confiance peut aussi être traduit comme avoir foi en quelqu’un. L’auteur lui-même définit le mot : « Par espérance, j’entends cette attitude qui, espérant contre tout espoir, est capable de franchir les obstacles humains initiaux, notre faiblesse et nos adhésions inconscientes, mais qui est aussi capable d’aller au-delà de toutes les formes de visions profanes, au cœur même du dialogue, comme un appel supérieur vers l’accomplissement d’un devoir sacré ».[57] L’espérance, comme la confiance, est donc une attitude humaine, un élan particulier, une force qui mobilise.
Dans la société contemporaine évolue une progressive et cancérigène méfiance, implicite dans toutes les relations. Panikkar est convaincu que cela est dû à l’isolement dans lequel se trouve l’homme d’aujourd’hui. En supprimant les relations ou en les basant sur la méfiance, l’homme est incapable de vivre dans l’harmonie et la sérénité. La méfiance porte vers l’animosité et la guerre. On se méfie de tout, de l’autre, de la nature, des proches et des lointains. La confiance, elle, porte vers la paix et l’amour. Il faut commencer à croire au projet humain, à la collaboration entre tous les humains dans la seule et même aventure de l’être, dit Panikkar.
La confiance doit aussi s’apprendre, cela implique rompre avec le cycle de la violence que la société consumériste impose. Autrui n’est pas mon ennemi mais mon partenaire. Dans le contexte actuel, la confiance est aussi une vertu. Il faut croire non seulement en Dieu et en l’homme mais aussi au cosmos. Panikkar parle de faire confiance au « principe cosmologique »[58] qui a rapport à la question qu’on se posait avant : Pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas rien ? Cela veut dire croire qu’il y a quelque part un fondement, un dernier fondement de tout : « L’ultime fondement pour cette confiance cosmique repose sur la conviction, quasi universelle, qui croit que la réalité est ordonnée, en d’autres mots, elle est bonne, belle et vraie ».[59]
La collaboration
La solidarité est comprise dans l’actualité en relation aux pauvres, aux exclus, aux victimes. A. Comte-Sponville lie la solidarité à une sorte de socialisation de l’égoïsme : « Etre généreux, c’est se libérer, au moins partiellement, de l’égoïsme. Etre solidaires, c’est être égoïstes ensemble et intelligemment. […] La solidarité est le contraire de l’égoïsme. La solidarité serait plutôt sa socialisation efficace ».[60] Chez Panikkar la collaboration est attachée à la solidarité. Etre solidaire signifie se sentir membre d’un ensemble plus ample. Il dit : « Aucune culture, religion ou tradition ne peut résoudre isolément les problèmes du monde ».[61] Comme toile de fond de la collaboration et de la solidarité se trouve le pluralisme. L’acceptation du pluralisme est ainsi essentielle. Il ne pourra pas y avoir de collaboration sans avoir accepté auparavant l’existence précieuse d’autrui. En effet, l’uniformité et l’unicité n’ont pas besoin de la solidarité. Un esprit unique n’a pas besoin d’autres. C’est dans le pluralisme que la collaboration et la solidarité ont du sens.
L’amour
Cette vertu, si l’on peut encore l’appeler ainsi, est celle sur laquelle la tradition – autant philosophique que théologique – s’est le plus longuement exprimée. Chez Panikkar, tout ce qui a été dit précédemment n’est pas possible sans amour. Comte-Sponville le croit aussi : « Sans l’amour, que resterait-il de nos vertus ? ».[62] Panikkar le dit ainsi : « Il n’y a pas de rapport humain sans amour, sans quelque passion, jusque, possiblement, la haine ».[63] L’amour est donc premier, il est le commencement et la fin de toute vertu.
Dieu, l’Homme et le Monde forment une communauté d’amour, une communauté de relations constitutives. L’amour est plus que le pont qui met en relation les uns avec les autres, il est ce qui leur donne existence. Tout est fait de relations, rien ne peut exister ou subsister de manière isolée. Ce qui veut dire que sans amour il n’y a plus que l’absence d’être, la mort, la disparition, le néant. Renoncer aux relations avec notre entourage, c’est renoncer aussi à l’amour et cela représente la mort. Lorsqu’une vie est privée d’amour, elle n’a plus de sens. L’homme, ainsi que le monde meurent sans amour.
Chez notre auteur, l’amour pourrait se traduire de bien d’autres manières. Nous en retenons deux : l’amour est en effet synonyme de simplicité, mais aussi de renoncement. On pourrait dire, dans le contexte qui nous occupe, que l’amour n’implique pas une donation, mais plutôt un renoncement, c’est-à-dire une vie simple.

L’amour compris comme renoncement. Pour Panikkar : « Aimer son prochain comme soi-même ne signifie pas lui vouloir du bien comme à un être séparé, mais veut dire élargir mon cœur (amour) de telle sorte que l’autre devienne une partie de moi-même ».[64] Il n’est pas simplement question de donner quelque chose à autrui. L’amour est plutôt compris ici comme un saut hors de notre centre, autrement dit, comme un renoncement à soi-même pour regagner notre véritable identité : l’autre fait aussi partie de mon moi. Mais, pour que l’on puisse arriver à sortir (transcender) de nous-mêmes, il faudrait d’abord connaître « le noyau infini qui habite dans notre immanence ».[65] Ainsi, de même que la foi est l’ouverture vers l’ineffable, de même l’amour est l’ouverture vers l’autre et la connaissance l’ouverture vers soi-même. Il faudrait donc comprendre l’amour non pas comme une donation des choses extérieures mais comme un renoncement. En d’autres termes, il faut passer du « donner » au « ne pas prendre ». Vouloir donner du surplus peut signifier prendre de ce qu’on a pour soulager les besoins d’autrui. Si cela peut bien être un acte d’amour, il le sera davantage si l’autre est considéré comme une partie de moi-même. Aimer est être catapulté vers l’aimé pour reconnaître ensuite qu’il n’est pas loin de moi, mais qu’il fait partie de moi. Car « connaître vraiment, c’est devenir la chose connue sans cesser d’être ce que l’on est »[66], assure notre auteur.
Cette idée du renoncement peut être aussi rapprochée de l’idée de non-puissance défendue par J. Ellul, comprise comme récusation du ou renoncement au pouvoir. Il affirme : « Il n’y a de liberté que dans la conquête de la liberté. Aucun pouvoir ne peut donner de la liberté aux hommes. La récusation du pouvoir est la seule voie de l’actualisation d’une liberté ».[67] Dans ce sens, l’amour exige forcément de renoncer au pouvoir. Ellul ajoute : « C’est en combattant contre le pouvoir que se forgent les qualités humaines, la vertu, le courage, la solidarité, la loyauté…Encore faut-il que ce combat soit mené avec les armes de la vérité, de la justice, de l’authenticité (et j’ajouterais volontiers, de la non-violence) ».[68]
L’amour compris comme simplicité. Panikkar rapproche la simplicité de la vie monacale dont le principe fondamental est la simplicité qui peut être aussi un principe de vie de tout homme. Le mode de vie des contemporains est devenu très compliqué. L’homme est préoccupé et angoissé parce que la vie accélérée et remplie de choses le domine et le déconcerte. La vie monacale dans le monde prêchée par Panikkar implique une réaction radicale contre cet état de choses. « Le moine est un anticonformiste »[69], dit Panikkar, il est celui qui va à contre-courant. Le moine est donc celui qui est arrivé à se libérer de ses fausses envies. Il sait donc mener une vie simple, simplicité qui est dans son cœur et qui se reflète dans son corps. Le moine habite la simplicité parce qu’il a été capable de reconnaître le véritable rythme de la vie. La vie monacale dans le monde est en elle-même une critique du temps accéléré. Panikkar comprend cette vie monastique ou monacale comme la recherche de l’absolu, comme la quête de l’ab-solu, c’est-à-dire de la libération de la multiplicité.
6.
7. Conclusion
L’invitation de Panikkar est à présent plus claire. Il est nécessaire que l’homme contemporain revienne sur lui-même, il doit retrouver son monde intérieur pour pouvoir aller vers les autres. Sans connaissance de soi, il n’y a pas non plus connaissance de l’autre et sans cette connaissance, il n’y a pas d’amour possible. L’intériorisation implique faire silence, faire taire tous les bruits extérieurs pour écouter la voix du cœur. Ce silence intérieur est également la condition nécessaire pour l’acquisition de toutes les vertus : justice, dialogue, confiance, collaboration et amour.
L’éthique que nous proposons, à la lumière de la pensée de notre auteur, est donc plus qu’un ensemble de normes à respecter, elle est une sagesse qui naît lorsque « l’amour de la connaissance et la connaissance de l’amour s’unissent ».[70] L’amour est le sommet de toutes les vertus, il implique une reconnaissance pleine d’autrui comme étant une partie de moi-même. Aimer l’autre veut dire aimer « l’étincelle qu’il y a en lui de l’Absolu qu’il est »[71], mais cette étincelle est aussi en moi, car l’amour est un courant qui circule en tous et qu’il faut reconnaître et maîtriser. L’amour peut être finalement compris comme la célébration de l’énergie qui est dans tous les êtres, c’est l’énergie de l’Absolu qui fait de tous une seule et même famille.
RÉSUMÉ
« La Terre est malade »[72], affirment aujourd’hui beaucoup de savants, fruit d’une vision du monde qui met par-dessus tout l’être humain, certains êtres humains, au détriment de la Vie comme un tout. Cette maladie n’est qu’un symptôme d’une autre crise plus grave, celle de l’être humain. La « crise écologique » pointe vers une « crise anthropologique » aussi tragique. Une société, avec le sens de la vie que les hommes se sont donnés, est en crise.
A la lumière de l’intuition cosmothéandrique de R. Panikkar, un renouveau semble s’imposer. La théologie doit aussi s’interpeller : il faudrait remettre la théologie en chantier. Tout particulièrement l’éthique théologique. Il faudrait sans doute reprendre la notion de communauté et élargir ses frontières de façon à ce qu’on tienne compte aussi de la terre tout entière. Car tous ont le droit d’exister, indépendamment du bénéfice de l’être humain. Nous proposons, dans cet essai, de reprendre, à nouveaux frais, l’éthique des vertus dans le contexte de la proposition du philosophe et théologien espagnol, R. Panikkar, une éthique que nous appelons écosophique.
[1] A. Leopold, Almanach d’un conté des sables, Paris, Garnier-Flammarion, 2000, p. 257.
[2] A. Thomasset pense que le passage d’une morale du bonheur et des vertus à une morale de l’obligation a été opéré par le courant nominaliste. Ainsi, par exemple, pour Ockham, « seul importe le rapport des deux libertés humaine et divine, et ce rapport est pensé en termes d’obligation. La volonté divine s’exprime par une loi que l’homme doit connaître et appliquer ». Voir A. Thomasset, Interpréter et agir. Jalons pour une éthique chrétienne, Paris, Cerf, 2011, p. 157.
[3] Voir S. Pinckaers, Les sources de la morale chrétienne. Sa méthode, son contenu, son histoire, Paris, Cerf, 1990.
[4] R. Panikkar, Ecosofía. Para una espiritualidad de la tierra, Madrid, San Pablo, 1993, p. 151.
[5] Cité par J. B. Callicot, Ethique de la terre, Marseille, Éditions Wildproject, 2010, p. 101.
[6] G. Casalis, Les idées justes ne tombent pas du ciel, Paris, Cerf, 1977, p. 141.
[7] Ce processus de reterritorialisation implique de nouvelles relations sociales, la reconnaissance de l’autre et de la diversité, signifie retourner ce qui appartenait originellement à d’autres, tant leurs territoires physiques que leurs identités ; voir G. De Marzo, Buen vivir. Per una nuova democrazia della terra, Rome, Ediesse, 2009, p. 101.
[8] Voir S. Latouche, Décoloniser l’imaginaire, Lyon, Parangon, 2005, notamment son introduction.
[9] A. Costa, El Buen Vivir. Sumak Kawsay, una oportunidad para imaginar otros mundos, Barcelone, Icaria, 2013, p. 66.
[10] R. Panikkar, El Espíritu de la política, Barcelone, Ediciones Península, 1999, p. 133.
[11] A. Thomasset, Les vertus sociales. Justice, solidarité, compassion, hospitalité, espérance, Paris, Editions jésuites, 2015, p. 8.
[12] Ibid., p. 21.
[13] Voir les intéressantes réflexions de C. et R. Larrère sur ce sujet dans l’ouvrage Penser et agir avec la nature. Une enquête philosophique, Paris, éditions La Découverte, 2015, notamment l’introduction et le premier chapitre.
[14] P. W. Taylor, « L’éthique du respect de la nature », H.-S. Afeissa (dir.), Ethique de l’environnement. Nature, valeur, respect, Paris, Vrin, 2007, p. 118.
[15] J. B. Callicot, « La valeur intrinsèque dans la nature : une analyse métaéthique », H.-S. Afeissa (dir.), Ethique de l’environnement. Nature, valeur, respect, op. cit., p. 219.
[16] C. Pelluchon, Eléments pour une éthique de la vulnérabilité. Les hommes, les animaux, la nature, Paris, Cerf, 2011, p. 143.
[17] R. Panikkar, Paix et désarmement culturel, Arles, Actes Sud, 2008, p. 49.
[18] Ibid., p. 106.
[19] R. Hauser dit, suivant Luther, que « le Dieu occulte et mystérieux est entièrement impénétrable dans ses desseins » ; voir R. Hauser, « Poder », Conceptos fundamentales de teología II, Madrid, Cristiandad, 1979, p. 482-500 ; cité par J. L. Meza. La antropología de Raimond Panikkar y su contribución a la antropología teológica cristiana, Thèse doctorale, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2009, p. 107, note 8.
[20] R. Panikkar, La nueva inocencia, Estella (Navarra), Verbo Divino, 1999, p. 58.
[21] Ibid., p. 59.
[22] Voir R. Panikkar, Mito, fe y hermenéutica, Barcelone, Herder, 2007, p. 304.
[23] R. Panikkar, Mystique, plénitude de vie, Paris, Cerf, 2012, p. 378.
[24] Quand ils furent repus, il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux en surplus, afin que rien ne soit perdu » ; ut autem impleti sunt dixit discipulis suis colligite quae superaverunt fragmenta ne pereant ; Jn 6, 12 ; voir R. Panikkar, La puerta estrecha del conocimiento. Sentidos, razón y fe, Barcelone, Herder, 2009, p. 13; La intuición cosmoteándrica, op. cit., p. 16-20.
[25] R. Panikkar, La intuición cosmoteándrica, op. cit., p. 13;
[26] Ibid., p. 4.
[27] R. Panikkar, El mundanal silencio. Una interpretación del tiempo presente, Barcelone, Ediciones Martínez Roca, 1999, p. 37.
[28] Cette idée renvoie sans doute à l’hypothèse Gaïa de J. Lovelock.
[29] Ibid., p. 178.
[30] Idem.
[31] Ibid., p. 35.
[32] Théorie développée aux Etats-Unis par Carol Gilligan, dans les années 1980, dans le cadre d’une psychologie du développement moral.
[33] R. Panikkar, Paix et désarmement culturel, Arles, Actes Sud, 2008, p. 31-32.
[34] R. Panikkar, La plénitude de l’homme, Arles, Actes Sud, 2007, p. 31.
[35] C. Larrère, « Care et environnement : la métaphore du jardin », S. Laugier, Tous vulnérables ? Le care, les animaux et l’environnement, Paris, Payot, 2012, p. 250.
[36] Joan Tronto propose de traduire le mot « care » à la fois par sollicitude et soin ; voir J. Tronto, Un monde vulnérable. Pour une politique du care, Paris, La Découverte, 2009, p. 142.
[37] Ibid., p. 143.
[38] P. Molinier ; S. Laugier ; P. Paperman, Qu’est-ce que le care ? Souci des autres, sensibilité, responsabilité, Paris, Payot, 2009, p. 24.
[39] Ibid., p. 12.
[40] J. Tronto, Un monde vulnérable. Pour une politique du care, op. cit., p. 168.
[41] R. Panikkar, Ecosofía, op. cit., p. 147.
[42] M. Gaille, « De la crise écologique au stade du miroir moral », S. Laugier, Tous vulnérables ? Le care, les animaux et l’environnement, op. cit., p. 227.
[43] A. Comte-Sponville, Le bonheur, désespérément, Paris, Editions Pleins Feux, 2010, p. 47.
[44] J. Renard, Journal, 9 avril 1895 (Edition 10-18, 1984, tome I, p. 265) ; cité par A. Comte-Sponville, Le bonheur, désespérément, Paris, Editions Pleins Feux, 2010, p. 49.
[45] Sâmkhya-Sûtra, IV, II ; cité par M. Eliade, Le Yoga, Paris, Payot, 1972, chap. I, rééd. 1983, p. 40 ; cité par A. Comte-Sponville, Le bonheur, désespérément, op. cit., p. 48.
[46] R. Panikkar, El mundanal silencio, op. cit., p. 56.
[47] Ibid., p. 33.
[48] Ibid., p. 81.
[49] A. MacIntyre, Après la vertu. Etude de théorie morale, Paris, Puf, 1997, p. 200.
[50] R. Panikkar, Entre Dieu et le cosmos. Entretiens avec Gwendoline Jarczyk, Paris, Albin Michel, 1998, p. 198.
[51] R. Panikkar, Paix et désarmement culturel, op. cit., p. 127.
[52] Ibid., p. 199.
[53] R. Panikkar, Pluralisme et interculturalité, Paris, Cerf, 2012, p. 310.
[54] R. Panikkar, Sobre el diálogo intercultural, op. cit., p. 51.
[55] Ibid., p. 91.
[56] R. Panikkar, Pluralisme et interculturalité, op. cit., p. 317.
[57] R. Panikkar, Le dialogue intrareligieux, Paris, Aubier, 1985, p. 90.
[58] R. Panikkar, Sobre el diálogo intercultural, op. cit., p. 142.
[59] Idem.
[60] A. Comte-Sponville, « Solidarité », Dictionnaire philosophique, Paris, Puf, 2001, p. 544-547.
[61] R. Panikkar, Paix et désarmement culturel, op. cit., p. 50.
[62] A. Comte-Sponville, Petit traité des grandes vertus, Paris, Puf, 1995, p. 296.
[63] R. Panikkar, Pluralisme et interculturalité, op. cit., p. 407.
[64] R. Panikkar, Mystique, plénitude de vie, Paris, Cerf, 2012, p. 101-102.
[65] Ibid., p. 378.
[66] Ibid., p. 101.
[67] Ibid., p. 223.
[68] Ibid., p. 225.
[69] R. Panikkar, Eloge du simple, op. cit., p. 53.
[70] R. Panikkar, Invitación a la sabiduría, Barcelone, Círculo de Lectores, 1998, p. 143.
[71] R. Panikkar, Mito, fe y hermenéutica, op. cit., p. 305.
[72] L. Boff utilisait cette expression en 1996 dans son livre Ecología : grito de la Tierra grito de los pobres, Madrid, Trotta, p. 13.